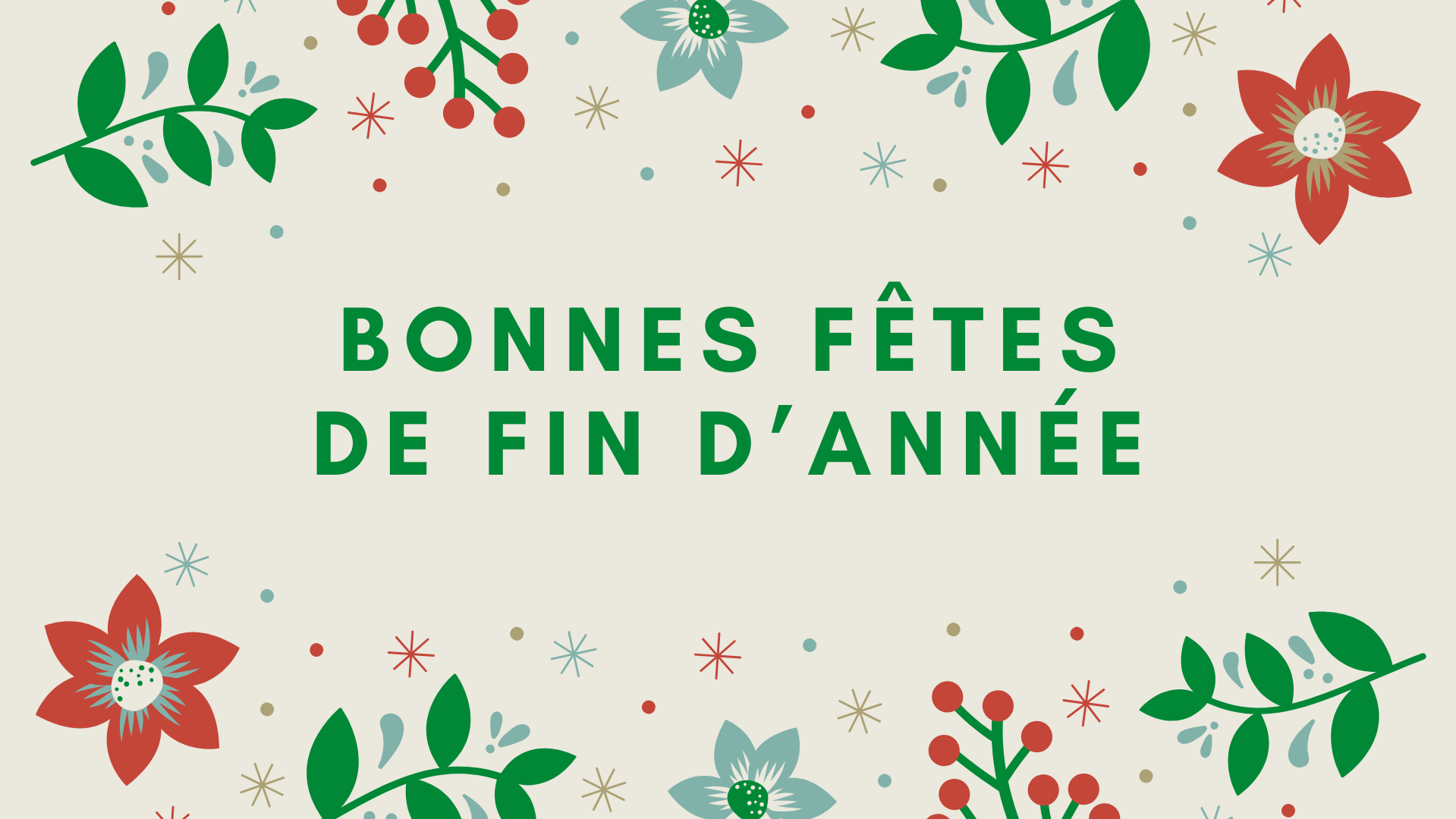La loi dite Duplomb, visant à « lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur », arrive au vote à l’Assemblée nationale. Ce texte ne peut être lu isolément. Il s’inscrit dans un contexte plus large de remise en question de décisions écologiques, marqué ces derniers mois par des attaques contre les agences environnementales comme l’Office français de la biodiversité (OFB) ou l’Ademe et des reculs assumés sur plusieurs fronts de la transition.
Si certaines simplifications peuvent répondre à des besoins réels dans la gestion des exploitations agricoles, elles ne doivent pas masquer un glissement plus préoccupant : celui d’un discours de plus en plus hostile à l’écologie, banalisé jusque dans l’hémicycle.
Il est donc essentiel de rester vigilants : simplifier, oui ; mais sans renoncer à l’ambition environnementale ni affaiblir les garde-fous qui protègent le vivant.
Redire nos fondamentaux
Nous tenons à réaffirmer sans ambiguïté nos engagements :
- Oui à l’agriculture biologique et aux modèles agroécologiques,
- Oui à la réduction massive de l’usage des intrants chimiques, en particulier les substances dangereuses pour la santé humaine et la biodiversité,
- Oui à une agriculture qui intègre le vivant dans ses logiques de production,
- Oui à un modèle équitable, capable de rémunérer justement celles et ceux qui nourrissent la population, tout en protégeant les écosystèmes.
La transition écologique est une exigence, non une option. Elle ne peut être remise en cause à chaque crise ou à chaque alternance. Mais elle ne pourra aboutir qu’à condition d’être tenable, accompagnée et démocratiquement construite.
Un texte qui inquiète sur plusieurs points
La loi Duplomb présente un certain nombre de dispositions qui peuvent apparaître comme des simplifications de bon sens. Mais en l’état, plusieurs aspects soulèvent de réelles inquiétudes :
- La suppression de plusieurs articles encadrant le conseil phytosanitaire, le retour facilité de certaines dérogations pour des produits interdits en France remet en cause les garanties apportées par la réglementation actuelle.
- L'affaiblissement du cadre de la consultation environnementale dans les projets d’élevage, en remplaçant les réunions publiques par de simples permanences, réduit l’espace du débat démocratique sur les territoires.
- L’absence d’engagements concrets sur le financement du bio, alors même que ce secteur connaît des difficultés majeures, contraste avec les assouplissements offerts à d’autres formes de production.
Il ne faut pas que, sous couvert de levée des "contraintes", on ouvre la voie à une remise en cause des avancées environnementales.
Une cohérence à reconstruire entre écologie, commerce et souveraineté
En parallèle, une autre ligne de fracture est devenue intenable et nourrit le sentiment anti-écologique : la France interdit certains produits sur son sol, tout en important des denrées produites avec ces mêmes substances. On demande aux agriculteurs de faire toujours mieux, tout en les exposant à une concurrence internationale fondée sur des normes plus laxistes.
Il est temps de rétablir une cohérence entre nos ambitions écologiques, nos règles commerciales et nos exigences de souveraineté alimentaire. La transition ne peut réussir si elle est vécue comme une forme d'injustice structurelle.
La crise de confiance est profonde et politique
La montée des votes de rejet dans les campagnes, les accusations d’« écologie punitive », les fakenews qui prospèrent sur les réseaux doivent nous alerter. Ce n’est pas la transition elle-même qui est rejetée, c’est l’impression d’une transition imposée, opaque, technocratique.
Il faut une méthode :
- Des objectifs clairs, assumés et stables dans le temps,
- Une concertation sincère avec les acteurs de terrain, en agriculture comme ailleurs,
- Une pédagogie constante pour rappeler le sens de l’action publique et les raisons du changement,
- Un accompagnement massif, économique, humain, technique, à la hauteur des transformations exigées.
C’est cette méthode, démocratique et crédible, qui permettra d’opposer un récit positif et mobilisateur aux discours de dénigrement ou de repli.
Ne rien céder, mais tout expliquer
Ce qui se joue avec la loi Duplomb dépasse l’agriculture. Depuis plusieurs mois, les signaux de recul se multiplient : sur le financement du bio, sur la rénovation thermique, sur les transports durables, sur les ambitions de la planification écologique.
Pendant ce temps, le climat continue de se dérégler, la biodiversité s’effondre et les coûts de l’inaction explosent.
Nous n’avons pas le luxe de ralentir. Nous avons besoin d’une transition assumée, portée collectivement et ancrée dans le réel.
Cela suppose de ne pas céder aux lobbys, mais de les écouter pour mieux répondre. Cela suppose de combattre la désinformation, mais aussi de comprendre les inquiétudes qu’elle exploite. Cela suppose enfin de ne jamais perdre de vue la finalité : protéger le vivant, garantir notre souveraineté, préserver notre démocratie.
Démocrates pour la Planète appelle à maintenir le cap de la transition. Non pas en le rigidifiant, mais en le rendant désirable, juste, partagé.
Parce que les Français sont prêts à faire leur part ; à condition de savoir pourquoi.
Parce que l’écologie est une promesse d’avenir ; à condition qu’elle reste un projet de société.
Parce qu’il n’y a pas d’alternative crédible à une transition écologique construite avec les citoyens.
David Guillerm, Président de Démocrates pour la Planète
et le comité exécutif